« On n’a plus confiance » : la relation cassée jeunes des quartiers/police

- Dans le cadre d’une concertation, le Département sonde sa jeunesse. Au programme, santé mentale, logement ou encore relations avec les forces de l’ordre…
- Plusieurs jeunes ont pris la parole à l’invitation des associations Ghett’up et le Tilia, pour exprimer leur lassitude des contrôles au faciès, le sentiment de peur lors de contacts avec la police.
- Ces constats doivent déboucher sur une stratégie jeunesse globale qui permettra notamment au Département d’interpeller l’État.
« Tous égaux face à la police ? » Voilà le thème qui était proposé le samedi 6 septembre par l’association Ghett’up aux jeunes du Cercle, un groupe de parole se réunissant tous les mois pour débattre de différents sujets.
Au Blanc-Mesnil, au café associatif Le Tilia situé dans le quartier populaire des Tilleuls, le thème avait attiré une trentaine de jeunes, habitant·e·s de Seine-Saint-Denis mais aussi plus loin en région parisienne. Pensé pour favoriser le lien social, ce Cercle se doublait cette fois d’une autre utilité : donner de la matière au Conseil départemental pour nourrir ses politiques publiques en direction de la jeunesse, qu’il souhaite rénover cet automne. « En plus de guider nos propres politiques publiques, vos propos peuvent aussi nous aider à interpeller d’autres partenaires, par exemple l’Etat sur un sujet comme celui des relations jeunes-police », expliquait Oriane Filhol, conseillère départementale en charge de la lutte contre les discriminations.
Et les griefs des jeunes présents étaient lourds contre une institution dans laquelle, majoritairement, ils n’ont plus confiance. On ne gâchera pas trop le suspense en révélant d’ores et déjà que la salle à l’unanimité a répondu « non » à la question de départ : « non, nous ne sommes pas tous égaux face à la police. »
« Un soir, lors d’une maraude Gare de Lyon, on s’est fait contrôler, témoignait ainsi Olivia*. Et là s’est produit un truc qui m’a vraiment choquée : ils ont mis les Noirs et les Arabes du groupe de maraude d’un côté, les Blancs comme moi de l’autre. Et ils ont contrôlé les premiers. La discrimination était évidente ».
Une avocate du barreau de Paris, présente en tant que bénévole, confirmait les propos de la jeune femme, confirmait les propos de la jeune femme. « C’est une évidence : les contrôles de police concernent beaucoup plus les jeunes hommes racisés que le reste de la population. » En novembre 2016, la Cour de cassation avait déjà condamné l’Etat pour « faute lourde », estimant que trop de contrôles d’identité en France sont discriminatoires.
« Attention, être une femme racisée, ce n’est pas forcément mieux. C’est juste que la discrimination va prendre d’autres formes. Par exemple ça va être très vite des commentaires sexistes. J’ai déjà eu droit à des commentaires sur la voiture que je conduis, « pas mal du tout pour une femme ». C’est dégradant », racontait Samia, modératrice du débat pour Ghett’up.
« Ce qui est au fond du problème, c’est leur manière de nous voir. »
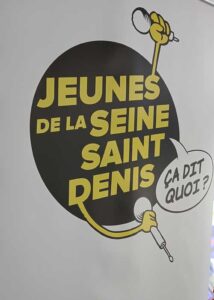 Des propos qui très vite faisaient remonter à la surface la dernière vidéo en date d’une violence policière survenue à Saint-Denis, le 5 septembre. Elle montre un jeune homme dans une attitude non agressive qui, lors d’un contrôle de police, reçoit d’abord une énorme gifle d’un policier avant que celui-ci ne lui crache au visage. Une scène choquante qui vient s’ajouter à la longue liste des violences policières commises en banlieue depuis la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré en 2005 à Clichy-sous-Bois ou l’assassinat de Nahel Merzouk à Nanterre en 2023.
Des propos qui très vite faisaient remonter à la surface la dernière vidéo en date d’une violence policière survenue à Saint-Denis, le 5 septembre. Elle montre un jeune homme dans une attitude non agressive qui, lors d’un contrôle de police, reçoit d’abord une énorme gifle d’un policier avant que celui-ci ne lui crache au visage. Une scène choquante qui vient s’ajouter à la longue liste des violences policières commises en banlieue depuis la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré en 2005 à Clichy-sous-Bois ou l’assassinat de Nahel Merzouk à Nanterre en 2023.
Des événements récurrents, qui suscitaient dans l’assistance soit de la révolte, soit une certaine forme de fatalisme.
« Qu’est-ce qui fait qu’en voyant une personne racisée, les policiers se mettent dans cet état d’esprit ? Je pense que c’est largement dû aux médias qui nourrissent une certaine image de nous. Il y a aussi l’habit qui fait le moine : moi j’ai toujours fait en sorte de m’habiller à l’occidentale pour ne pas éveiller l’attention. », expliquait ainsi une jeune femme.
« Excuse-moi, lui répondait une autre, mais je ne pense pas que ce soit de notre responsabilité de rassurer la police. C’est à eux, qui représentent la loi, d’être rassurants. En plus d’être discriminés, on devrait être le bon Noir ou le bon Arabe ? Ce qui est au fond du problème, c’est leur manière de nous voir. »
Justement – et c’était là peut-être la limite de l’exercice – il manquait un policier pour leur répondre. « Un policier municipal qui veut vraiment faire changer les choses devait venir, mais il n’a pas pu au final », se désolait Samia.
« Pour moi, il n’y a pas que ta couleur de peau qui conditionne ton rapport à la police, ajoutait Marvin, un peu plus âgé : il y a aussi le lieu où tu grandis. Si tu vis en quartier pavillonnaire, je t’assure que la police, tu vas la voir moins. » « Et puis l’âge de ton premier contrôle est assez déterminant, renchérissait Samia. Moi j’ai vu des petits de 13 ans se faire plaquer au mur ou larguer en rase campagne à Gonesse et devoir rentrer par leurs propres moyens. Comment après ça tu veux avoir confiance en la police ? »
Le thème de l’impunité du corps policier en cas de dérives ou de « bavures » revenait aussi beaucoup. Une jeune fille, qui évoquait l’importance de porter plainte quand on estime avoir été bafoué dans ses droits, suscitait ainsi quelques rires dans l’assistance. « Quand on est une personne lambda face à une institution, c’est très dur de se battre. Dans certaines violences policières, oui, il y a eu des sanctions, mais elles sont toujours minimes par rapport aux torts causés », lui répondait une autre.
Une meilleure formation des policiers et des rencontres vivement souhaitées
A l’heure de nourrir la feuille de route du Conseil départemental, venait enfin le temps des recommandations. Là encore, la salle se divisait plus ou moins en deux camps. Il y avait ceux qui, comme Aymen, rejetaient catégoriquement toute possibilité d’améliorer la police telle qu’elle est actuellement, y voyant plutôt un problème « systémique » : « Pour moi c’est peine perdue. On ne changera pas le système de l’intérieur. Un exemple : après l’affaire Traoré, on a voulu interdire le plaquage ventral (qui selon plusieurs enquêtes a sans doute causé la mort d’Adama Traoré, en 2016, lors d’un contrôle de gendarmerie à Beaumont-sur-Oise). Le syndicat policier Alliance a refusé massivement ! Qu’est-ce que tu veux faire contre un système à qui on demande de se réformer pour être moins violent et qui refuse de le faire ? », argumentait le jeune homme.
Et puis, il y avait ceux qui comme Marvin, Rose ou Olivia croyaient encore en la possibilité de réformes pertinentes, surtout par rejet de l’immobilisme. « La police de proximité (démantelée par Nicolas Sarkozy en 2007, ndlr) ça peut aider. Je pense aussi qu’il faut organiser des débats avec le « camp d’en face » car ça peut aider à mieux se connaître. Un exemple : pour moi ils étaient tous pareils. J’ai un peu changé d’avis depuis que je suis devenu ami avec un OPJ (Officier de Police Judiciaire). Avec lui je trouve que la méthodologie est différente. », insistait ainsi Marvin. Parmi les autres pistes évoquées, il y avait aussi l’instauration longtemps attendue, jamais réalisée, du récépissé après un contrôle d’identité, des caméras portatives vraiment effective lors des contrôles et surtout une meilleure formation des policiers – « il faut 10 mois pour devenir policier, on est sérieux là ? »
La concertation jeunesse du Département doit maintenant se poursuivre par des rencontres entre professionnels – associations ou institutions – sur le thème du logement et la lutte contre les discriminations pour parvenir à une feuille de route globale à l’automne.
Christophe Lehousse
*Tous les prénoms ont été changés
Pour aller plus loin:
- Global police, la question policière dans le monde et l’histoire, une BD de Fabien Jobard
- Amendes, éviction et contrôle, la gestion des « indésirables » en région parisienne, une étude d’Aline Daillère et Magda Boutros- https://www.instagram.com/p/DKKe1wTodwO/?img_index=1




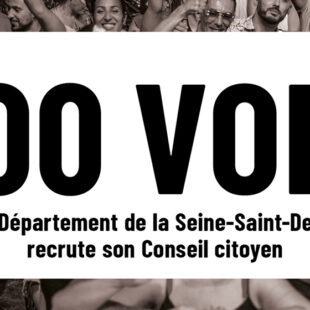




Tous les commentaires1
L’initiative d’une rencontre périodique entre Jeunes, Police et élus pour évoquer le mieux être et le vivre ensemble est souhaitable.
Comment mieux être dans la cité oblige à évoquer tous les aspects de la vie et de la reconnaissance mutuelle des uns et des autres, le respect du rôle des uns et des autres et ainsi de suite, peut améliorer les relations entre jeunes, Police, Elus et société.